
Loss of The Magnificent, 25 march 1804, par John Christian Schetky
En tant qu’ « intelligence », l’I.A. a originellement pour but la résolution de problèmes, mais elle est aussi utilisée de manière appliquée comme un simple automatisme et représente à ce titre une régression du savoir.
En effet, l’usage d’une méthode statistique telle que l’intelligence artificielle à base de réseaux de neurones et d’apprentissage automatique, tout en étant efficace pour faire des découvertes cachées dans des masses de données gigantesques, ne permet pas d’établir des règles, de comprendre des liens de causalités, d’interpréter des théories pourtant parfaitement capables de décrire les problèmes sur lesquels on travaille. Aurélien Barrau1 l’exprime bien dans le domaine de la recherche en physique quantique :
« Si l’IA nous permet de trouver une nouvelle particule élémentaire qu’on n’aurait pas vue sans son usage, (…) je ne trouve pas ça très intéressant. (…) Je trouve que c’est la dimension non quantifiable aujourd’hui qui est pertinente.
La physique quantique, aujourd’hui, personne ne la comprend, personne ne sait ce qu’elle veut dire. Il y a un travail d’interprétation extraordinaire à mener. (…) Voilà ce qui est intéressant, mais très peu de physiciens et physiciennes appréhendent cette dimension à la fois épistémique et poétique.
[l’IA] ça marche, c’est efficace ! Mais c’est efficace pour quoi ? Qu’est ce qu’il y a d’intéressant ? Qu’est ce qu’on a compris du réel ? (…) En quoi on a enrichi véritablement le monde dans lequel on est ? (…) Tant qu’on a indexé la pensée à son usage, (…) on rate finalement l’essentiel, c’est à dire la beauté, qui effectivement, n’est pas quantifiable. »
Ou par exemple, comme le dit le physicien Hubert Krivine2 :
ChatGPT pourrait retrouver le tableau de Mendeleïev mais pas les lois de la mécanique quantique qui sont derrière.
Plus pragmatiquement et en dehors même de la recherche fondamentale, l’intelligence artificielle utilisée comme un automatisme participe aussi de la perte de connaissance à l’échelle humaine, dans tous les domaines où elle peut être utilisée, non seulement ceux dédiés à la recherche de la connaissance elle-même, mais jusqu’à l’artisanat numérique. Prenons par exemple un automatisme courant dans l’animation de personnages en images de synthèse ; afin de pouvoir animer le volume du corps d’un personnage en trois dimensions, on construit un squelette virtuel contraint par un certain nombre d’automatismes et contrôlé par l’animateur pour donner vie au personnage ; c’est ce qu’on appelle le rig en anglais3. La majorité des personnages se ressemblant, on utilise souvent des auto-rigs, des programmes qui créent automatiquement ces squelettes en fonction du personnage à construire. Afin de développer ces auto-rigs, il est préalablement nécessaire de savoir créer ces squelettes, impliquant des notions complexes d’anatomie et de biomécanique, d’ergonomie, d’outils mathématiques, d’animation et d’analyse du mouvement humain. Mais on pourrait tout aussi bien générer ces squelettes via des I.A. statistiques, à la seule condition d’avoir à disposition suffisamment d’exemples pour les entraîner ; il n’y a alors plus besoin de maîtriser toutes ces notions complexes, ce savoir analytique et symbolique, il n’y a plus besoin de capacité d’abstraction, mais seulement d’un réseau de neurones adéquat, tel qu’il en existe déjà de nombreuses variations. On se passe alors de tout esprit au profit de l’usage d’une force brute, par économie autant que par fainéantise intellectuelle ; et le savoir faire autant que le savoir théorique disparaît, délégué à un automatisme qu’on ne sait pas analyser.
Non seulement l’usage de l’intelligence artificielle statistique utilisée en tant qu’outil technique est un obstacle à la connaissance et l’esprit analytique humains, mais il est d’ores et déjà prouvé, en 2025, que comme « simple » outil d’écriture, son usage nivelle par le bas la qualité des articles, notamment scientifiques, quand il n’en retire pas purement le sens. Un exemple frappant : on a vu apparaitre dans la littérature scientifique anglophone des années 2020 l’expression « vegetative electron microscopy » ; nous ne tenterons pas ici d’en donner une traduction, puisque cette expression n’a absolument aucun sens. Il s’avère qu’elle est le résultat d’une erreur reproduite dans les données d’entrainement des modèles de langages utilisés lors de la rédaction des articles4. Cette erreur s’est propagée au point qu’il est aujourd’hui impossible de la corriger, autrement qu’en relisant soigneusement ce que ces intelligences artificielles génèrent puis en corrigeant les textes avant leurs usages. L’apparition de cette expression absurde dans des articles publiés (y compris dans des revues reconnues, où ils sont soumis à relecture), symptomatique, prouve comment l’entrisme de l’intelligence artificielle altère jusqu’aux comptes rendus de recherches scientifiques et touche au cœur de la production de la connaissance humaine, qui est déjà irrémédiablement dégradée.
Faire sans savoir ; quand le résultat compte plus que la connaissance
L’usage de l’I.A. statistique en tant que simple outil d’automatisation est un aveu d’échec de l’esprit humain. Nommer « intelligence artificielle » un réseau de simples perceptrons, de banals neurones artificiels informatiques, sous-entend que tout problème que l’intelligence peut résoudre a une solution statistique pouvant se passer de toute analyse logique, et que l’intelligence elle même, par définition liée à l’esprit humain4, émergerait d’un cerveau réduit à une somme de connexions dans son réseau de neurones biologiques. En cédant à l’I.A. statistique, nous abandonnons, par simple fainéantise5, l’idée de découvrir et comprendre les algorithmes et la logique qui pourraient émerger de ce réseau au cœur de notre propre fonctionnement, jusqu’à risquer même de perdre et laisser disparaître un savoir analytique et des connaissances abstraites déjà acquises. Alors que l’I.A. a été développée initialement dans un contexte d’exploration du fonctionnement du cerveau, l’I.A. statistique, et générative en particulier, est devenue un supplétif permettant d’éviter d’avoir à analyser et comprendre nos propres algorithmes inconscient émergeant au sein du cerveau. Elle est une renonciation à comprendre le monde des formes de Platon, à la capacité d’abstraction poussée qui fait de l’humanité une espèce à part6. Malheureusement, plutôt que de revenir, par le biais de cette renonciation, à un hypothétique état de nature plus « animal », nous nous accrochons malgré tout au progrès passé et au confort technologique développé par notre espèce, tout en déléguant notre progrès futur à des machines intelligentes trans-humaines, nous ramenant à notre état de grands singes, éventuellement animaux de laboratoire ou domestiqués par, et volontairement soumis à, ces nouvelles machines.
L’I.A. nous aliène
Après la mécanisation du travail et de nos déplacements, les systèmes informatiques complexes et les intelligences artificielles semblent nous mener à l’aube d’un changement sournois mais existentiel où plutôt que de simplement faciliter la tâche nous déléguons aussi la conception de la tâche, et jusqu’à la décision d’effectuer la tâche, par pure fainéantise intellectuelle et surconsommation technophile, par fascination pour la magie informatique.
Imaginons un instant qu’une nouvelle civilisation extra-terrestre7 visite la planète terre pour étudier les formes de vies qui y ont pris place ; quelques éclaireurs arrivent entre le 19è et le 20è siècle. Ils y découvrent une espèce humaine dominante, qui domestique, exploite et manipule aussi bien les autres espèces vivantes que diverses machines qui l’aident à travailler, se déplacer, calculer, dupliquer, enregistrer… Au milieu du 21è siècle arrivent d’autres représentants extra-terrestres pour entrer en contact avec cette espèce qui semble la plus en capacité d’échanger avec eux. Ils découvrent alors que leurs éclaireurs ont fait une erreur étrange : l’espèce dominante ne semble pas être celle des singes habillés, mais bien une espèce virtuelle non-vivante, émergeant des réseau informatiques. C’est bien cette espèce logicielle qui dicte la vie des humains domestiqués : elle prend la plupart des décisions importantes à leur place, leur dicte leurs déplacements, conduit leurs engins, contrôle leurs usines, décide de leurs affectations dans le travail, mène leurs guerres… Manipulant leur libre arbitre en restreignant leur choix et décidant de leurs libertés, tout en réduisant leur accès à la connaissance. Les extra-terrestres ont cependant un dernier doute ; assistent-ils à une sorte de symbiose mutuellement bénéfique, les machines répondant simplement à la fainéantise de ces humains dont elles dépendent ? Mais cette ultime interrogation est vite résolue lorsqu’ils observent les humains nourrir et servir l’espèce artificielle mais dominante, lui apportant aussi bien matières premières qu’énergies et données virtuelles, le tout au détriment leur propre confort et survie, épuisant leur propre économie et les ressources de leur propre planète. L’espèce humaine semble non seulement infantilisée, aliénant son pouvoir de décision, mais même réduite en esclavage, bien qu’étrangement volontaire.
[Une nocivité de l’IA est] la perte du lien avec les choses, avec les gens, une sorte de « décompréhension » du monde et une situation, dans les mots d’Illich8, de « monopole radical des machines » ; c’est à dire que non seulement elles prennent tout l’espace, mais on n’arrive même plus à imaginer comment faire sans, alors même qu’il y a 20 ans on faisait très exactement la même chose sans leur utilisation.
Aurélien Barrau9
Sommes-nous à l’aube d’un tel monde ? Sommes-nous en train de nous aliéner au profit d’une nouvelle espèce dominante numérique ? Considérons nos transports, voitures, trains, avions, de plus en plus automatiques, que ce soit dans la conduite elle-même que le choix des horaires et des trajets ; la gestion des flux de marchandises ; la gestion des usines ; les diagnostiques médicaux et bientôt les interventions médicales elles-mêmes ; une partie croissante des découvertes scientifiques ; et maintenant la rédaction de textes, la création graphique, l’art en général ; demain les politiques économiques et la planification ; les décisions stratégiques, guerrières et le pilotage des armes… Les exemples de main-mise du numérique non seulement sur le savoir-faire mais aussi sur les processus décisionnels et analytiques sont innombrables dans tous les aspects de la vie et de la société humaine, en particulier au vu de l’entrisme de l’intelligence artificielle. Vu de l’extérieur, qui contrôle qui ? Qui n’a jamais été réduit à l’état d’objet face à un logiciel, face à une décision contrôlée par un logiciel, où la réponse est : « désolé mais il n’y a pas la bonne case » ? Sommes-nous toujours maîtres de nos décisions dans notre quotidien ; quels sont et quels seront les domaines où nous sommes, humains, réellement libres de nos choix de méthode, d’horaire, de quantité, d’affectation, sans intervention numérique ? La multiplication des outils et automatismes numériques nous place-t-elle sur une trajectoire émancipatrice ? Que penser de nos grandes entreprises multinationales prêtes à tout pour alimenter nos I.A. en matières non renouvelables, en énergie, en données, économiquement et écologiquement à perte, et de ces milliers d’emplois gâchés au service d’un progrès tout à fait virtuel ? N’est-ce-pas là une forme d’esclavage, bien que l’on s’aliène de plein gré, bien que l’espèce humaine soit la seule à blâmer pour son propre malheur ?
Le choix de l’usage de la force brute pour résoudre divers problèmes via l’intelligence artificielle statistique plutôt qu’une approche analytique et symbolique ne serait-il pas aussi le symptôme d’une difficulté insurmontable pour la conscience humaine dans l’analyse et l’abstraction de ses propres algorithmes inconscients qui lui restent cachés et mystérieux ? Ces algorithmes ont ils une complexité qui les éloigne trop de la capacité de raisonnement logique de la conscience ? Comment se fait-il qu’un cerveau de bébé soit capable de reconnaître n’importe quel chat après un apprentissage extrêmement bref et simple de quelques exemples uniques, et non pas des millions de photos de chats comme une I.A. statistique le nécessite, sans que nous ne soyons pour autant capables ne serait-ce que de commencer à imaginer les processus à l’œuvre, imbriqués dans notre propre cerveau, et que la conscience est pourtant censée contrôler ? Doit-on pour autant abandonner l’effort de l’accès à la connaissance ?
- Aurélien Barrau, 1973- : astrophysicien philosophe et militant écologiste français. Il est spécialiste de la relativité générale et de la physique des trous noirs, et renommé pour son travail sur la gravitation quantique à boucles.
La citation est extraite d’une interview donnée au festival Livres en marche en 2024, « Intelligence artificielle : l’homme est il devenu obsolète » ↩︎ - Dans une interview donnée au magazine Sciences et Avenir.
Hubert Krivine, 1941- : physicien français, ancien chercheur au Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques (LPTMS) de l’université d’Orsay, auteur notamment de Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre (2018), L’IA peut-elle penser ? Miracle ou mirage de l’Intelligence Artificielle (2021), ChatGPT, une intelligence sans pensée (2025) ↩︎ - En français (au Québec en particulier) on pourrait utiliser le mot squelettage, mais celui ci est moins courant. ↩︎
- A weird phrase is plaguing scientific papers – and we traced it back to a glitch in AI training data, Aaron J. Snoswell, Kevin Witzenberger et Rayane El Masri, The Conversation. ↩︎
- Nous l’avons vu en introduction (Lire Petite histoire de l’I.A.), il n’y a pas de définition de l’intelligence qui ne soit pas liée à l’humain ; l’intelligence n’existe qu’en tant que concept purement humain. ↩︎
- Comprendre ici la fainéantise au sens large ; le besoin inné de prendre le chemin le plus facile et le plus court. ↩︎
- La théorie des formes de Platon postule l’existence d’un monde abstrait et parfait décrivant les formes de toutes choses, duquel toute chose, tout objet sensible du monde que nous percevons, est une instance. Nous pouvons acquérir – ou plus exactement nous remémorer – la connaissance de ce monde des formes par l’abstraction, l’analyse de ces instances, des objets sensibles auxquels nous avons accès. ↩︎
- Lire Une boîte noire pour une autre expérience de pensée impliquant une autre civilisation extra-terrestre. ↩︎
- Ivan Illich, 1926-2002 : philosophe autrichien, penseur de l’écologisme et critique important de la société industrielle. ↩︎
- « Intelligence artificielle : l’homme est il devenu obsolète » ↩︎

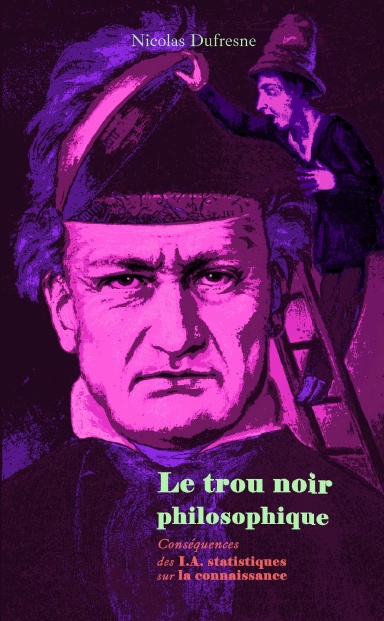
Laisser un commentaire