
Peinture murale de Teotihuacan
Il est difficile d’évoquer le Mexique aujourd’hui sans penser aux alebrijes, ces sculptures d’art populaire inventées par Pedro Linares en 1936, de créatures fantastiques aux nombreuses couleurs vives ; ou de penser aussi au « Dia de los muertos », le jour des morts, déclinaison mexicaine de la fête des morts chrétienne, qui fait aussi la part belle aux couleurs, notamment avec les calaveras, têtes de mort, en sucre, ou en céramique pour accueillir des bougies, et toutes leurs représentations de préférence vives et multicolores. Ces représentations ont été en fait promues dans les années 1920 par les gouvernements nationalistes, dans le but d’unifier le pays après la révolution de 1910, particulièrement par le biais du mouvement muraliste1.

Alonzonoriegamx, 2019, CC-BY-SA


Gzzz, 2018, CC-BY-SA
Quoi qu’il en soit, les couleurs vives et les teintes en général semblent provenir d’un héritage culturel bien plus ancien, qui remonterait aux civilisations précolombiennes mésoaméricaines, qu’on peut redécouvrir par les codex2 et l’architecture qu’elles nous ont laissé, mais aussi leur langue, le nahuatl. Elle est encore parlée par presque deux millions de personnes aujourd’hui, surtout au Mexique et un peu aux États-Unis, alors qu’elle remonte au moins au 7e siècle et prend ses racines dans la langue ute, il y a 7 000 ans, ce qui en fait une famille de langues similaires à l’indo-européen.
Le nombre et la précision des mots y désignant les couleurs sont impressionnantes. Par exemple, trois mots désignent les jaunes et trois autres les blancs ; quatre mots pour les rouges, et pas moins de douze mots au total pour les verts et les bleus, qui se confondent, sans frontière bien définie, alors que les Aztèques considèrent le bleu-vert comme une couleur pure3. On peut par exemple différencier le bleu marine, « toxapalatl », du bleu sombre, « matlalli » ou du bleu ciel, « texotli », tous différents du bleu « xiuhuitl » ; quatre mots différents pour quatre couleurs résumées sous le seul terme bleu en français (ou en espagnol) auquel il nous faut ajouter un qualificatif pour les différencier. Selon Eulalio Ferrer4, pour comprendre l’importance des teintes vertes et bleues dans la culture Aztèque, il faut imaginer le panorama luxuriant dans lequel ils vivaient, de lacs, rivières et végétation où les bleus de l’eau et les verts des cultures se fondent. Les aztèques appelaient la mer « eau céleste » car ils pensaient que la mer, verte, se fondait à l’horizon dans le ciel bleu. En nahuatl, « chalchihuitl » est le bleu-vert par excellence, symbole du liquide et des bonnes récoltes, mais aussi des pierres précieuses et mystiques, le jade et l’émeraude, qui représentent le cœur humain et l’essence divine, source de la vie. Le jade représente l’eau qui fertilise la terre, et Chalchiuhtlicue, la déesse à la jupe de jade, est la déesse de l’eau vive bleu-verte. Xiuhtecuhtli, littéralement le « seigneur bleu-vert » ou « turquoise », est un des plus anciens dieux aztèques, le dieu du feu et du temps, le principe créateur, qui amène la vie sur terre, offre l’abri et la chaleur. On ne sait pas pourquoi le dieu du feu est ainsi principalement associé au bleu turquoise, mais lors de certaines cérémonies du feu, quatre esclaves lui étaient sacrifiés, symbolisant les quatre couleurs du feu aztèque : le feu bleu ciel, le feu jaune, le feu blanc et le feu rouge.

Les couleurs sont déjà importantes dans la cosmogonie Aztèque. Au plus élevé des cieux, le treizième, vit Ometeotl, dont le nom signifie « deux énergies », l’entité suprême, immatérielle, éternelle et transcendante, créatrice unique et parfaite de toute chose ; celui qui s’invente lui-même, qui se trouve partout, par qui on vit. Au commencement, Ometeotl s’est divisé en deux divinités, Ometecuhtli, l’essence masculine de la création, et Omecihuatl, l’essence féminine. Ce couple divin engendra alors les quatre dieux créateurs : le premier est Xipe Totec, l’écorché, rouge, dieu du renouveau de la nature, de l’agriculture et des pluies nocturnes fertiles, qui s’écorche pour nourrir l’humanité, symbolisant ainsi le grain de maïs perdant son enveloppe avant de germer5 ; le second est Tezcatlipoca, le miroir fumant, noir, est la plus crainte des divinités, dieu de la nuit, de la discorde, de la guerre et de la chasse, de la royauté, des sorciers, de la mémoire… ; s’y oppose Quetzalcoatl, le troisième, le serpent à plumes, blanc, créateur de la terre, alors associé avec Tezcatlipoca, puis créateur des hommes, et celui qui leur apporte le maïs, avant d’être poussé par Tezcatlipoca à s’immoler et que son cœur ne devienne l’étoile du matin ; le quatrième est Huitzilopochtli, le colibri de gauche, symbole du guerrier ressuscité, bleu, dieu du soleil et protecteur des Aztèques, qui partage avec Tlaloc, le dieu de l’eau, le Templo Mayor, gigantesque temple de Tenochtitlan, la capitale Aztèque. Ces quatre dieux auraient ouvert un chemin sous la terre et vers le ciel, colorant chaque direction. Le chemin suivi par le Quetzalcoatl blanc et le Tezcatlipoca noir est marqué par un serpent blanc, Istacmixcoatl, la Voie lactée. On retrouve là la coloration des points cardinaux des croyances Mayas, qui voyaient la Terre comme une forme plate et carrée : le rouge à l’est, le blanc au nord, le noir à l’ouest et le jaune au sud. Le centre est, on le devine, vert ou bleu. On retrouve ici encore l’habituelle opposition noir-blanc et rouge, décidément universelle chez l’humain ; les couleurs des quatre éléments gréco-romains correspondent d’ailleurs aux couleurs des points cardinaux mayas. Certains Mayas croyaient aussi que le ciel était soutenu par quatre arbres de couleurs et d’espèces différentes, et le ceiba6 vert se dressait au centre.
Dans ce monde mésoaméricain précolombien multicolore, il en est une qui est restée unique, le bleu maya, issu d’un procédé permettant d’obtenir une teinte entre le bleu ciel et un turquoise vif, qui a la particularité de très bien résister à l’épreuve du temps. Cette coloration, dont le savoir-faire a été perdu, est en fait composée d’un pigment bleu, issu de fleurs du genre Indigofera ou Commelina7, et aussi d’argile, qui lui donne sa longévité. On tire d’ailleurs un pigment indigo similaire en Europe d’une autre fleur du genre Indigofera ; alors que les mayas et leurs descendants se servent d’Indigofera suffruticosa, c’est Indigofera tinctoria, « l’indigo des teinturiers », originaire d’Inde et cultivé depuis 4 000 ans, qui est utilisé en Europe. Il semble par contre que l’usage de ce genre de fleurs soit bien antérieur en Amérique, avec des traces de pigment indigo vieilles de 6 000 ans, retrouvées sur des textiles au Pérou. Tandis que l’indigotier d’Inde traverse l’Atlantique avec les européens au 16ᵉ siècle, et que les moines franciscains au Mexique se mettent à teindre leurs bures de bleu maya plutôt que d’utiliser gris traditionnel de leurs homologues européens, l’Indigofera suffruticosa des mayas n’est décrit par les européens qu’en 1768 pour la première fois. Il n’est plus cultivé de nos jours qu’à Santiago Niltepec dans l’état d’Oaxaca, au sud du Mexique, et offre un pigment bleu indigo unique. Les récentes récoltes de 2023 ont été très faibles à cause d’une grande sécheresse, ainsi que celles de 2024 à cause de pluies excessives ; il n’y aurait plus que 20 familles dans tout le Mexique qui produisent encore le pigment, dont la production diminue d’année en année malgré tous leurs efforts, à cause des tremblements de terre et de la météo rendue imprévisible par les changements climatiques, mais aussi de la pauvreté et du manque de soutien gouvernemental et institutionnel.
C’est vert 800 ans avant notre ère que le véritable bleu maya apparait, utilisé sur des sculptures ou en peinture murale, puis dans la rédaction de codex, mais c’est à partir du 8ᵉ siècle environ qu’on en a beaucoup de traces, alors qu’il est utilisé par les mayas, toltèques, aztèques… Après l’arrivée des Européens, il continue d’être utilisé dans des couvents du Mexique colonial, dans l’art indochrétien, combinaison des techniques européennes et amérindiennes. Le colorant disparait toutefois du Mexique après le 16ᵉ siècle, et ne subsiste plus qu’en peintures murales à Cuba8 jusqu’au milieu du 19e siècle. Il semble que ce bleu maya a joué un rôle important lors des sacrifices humains à Chichén Itza, pour le dieu Chaac. Le colorant bleu maya était produit sur le site sacrificiel et servait à peindre le corps des sacrifiés9. Chichén Itza est une des plus grandes et influentes villes mayas, entre le 7e et le 11e siècle, qui s’est développée autour de deux cénotes, de grands gouffres naturels emplis d’eau. « Chi » signifie d’ailleurs « bouche », et « chén », « puits ». Cette présence d’eau était très importante dans cette région sèche, ce qui aide à comprendre l’importance de Chaac, dieu maya et toltèque de la pluie, bienfaiteur des cultures, équivalent du grand dieu Tlaloc des Aztèques, et aide donc à deviner l’importance du bleu maya pour ces peuples. Comme d’autres dieux, Chaac est aussi multiple, et quatre Chaacs sont parfois associés aux quatre points cardinaux et leurs quatre couleurs.
La couleur était si importante dans les cultures nahuatl que des nouveaux pigments étaient recherchés partout, au-delà des pigments minéraux comme l’hématite rouge et l’ocre qu’on retrouve dès la préhistoire un peu partout dans le monde. Outre le bleu maya, de nombreux autres pigments sont végétaux : de la pulpe d’une variété d’hibiscus, on tire du violet ; des tiges de tournesol, du vert ; de la fleur des morts, un jaune profond. En faisant macérer certains bois, on obtient des teintures allant de la fumée au noir, tandis que l’écorce de chêne rouge bouillie avec de la chaux et de l’urine produit du jaune. D’autres pigments sont marins : on tire du pourpre à partir de mollusques, qui avaient une valeur rituelle et se récoltaient les nuits de pleine lune. Rapidement après l’arrivée des Européens, de nombreux pigments sont ainsi exportés et la production de teinture devient une activité florissante ; la cochenille mexicaine finit par servir à teindre les manteaux rouges de l’armée britannique, ou sur la palette du peintre espagnol El Greco10.


La cochenille est la principale source de rouge des civilisations nahuatl, et de grandes feuilles de cactus sont cultivées pour nourrir cet insecte parasite, qui produit l’acide carminique pour se protéger de ses prédateurs. Ironiquement, l’humain doit en tuer des milliers pour produire un seul grain de pigment tiré de cet acide, aujourd’hui exporté dans le monde entier. On obtient alors le pigment carmin, un rouge foncé, encore utilisé en peinture et autorisé comme colorant alimentaire sous le code E120, bien qu’on sache le synthétiser depuis 199111.
Le bleu-vert, turquoise, de l’eau, de la renaissance, de la fertilité, et le rouge du sang, de la sagesse et du soleil sont de loin les couleurs les plus présentes des civilisations mésoaméricaines, mais la civilisation Toltèque, autour du 10e siècle, affectionne aussi tout particulièrement le blanc et le jaune. Quetzalcoatl, le serpent à plumes blanc, revêt une importance particulière dans la mythologie toltèque ; c’est le dieu qui leur enseigne les arts : agriculture, métallurgie, écriture sacrée rouge et noire, sculpture, architecture, peinture… « C’était un très grand artiste, dans toutes ses œuvres et ses ustensiles, peints en bleu et vert, blanc, jaune et rouge… ». Les aztèques, qui se considèrent être les descendants des toltèques ayant migré dans la vallée de Mexico vers le 13ᵉ siècle, accordent aussi une importance particulière au blanc, à travers leur religion centrée sur la course du soleil. L’occident représente alors la demeure blanche et brumeuse où le soleil se couche, et les guerriers sacrifiés pour la régénération du soleil sont intégralement vêtus de blanc ; les dieux du panthéon aztèques portent aussi des ornements blancs12. Toutes ces couleurs et leurs pigments servent ainsi à la teinture des textiles bien sûr, mais aussi à l’écriture et l’illustration des codex, dont le cuir, le papier ou le tissu de coton qui les compose est préalablement blanchi à la chaux, et en peinture, corporelle ou sur les bâtiments.


La plupart des bâtiments en pierre mésoaméricains reposent sur une chape, qui peut être un simple rectangle de moins d’un mètre de haut, ou une pyramide pouvant s’élever jusqu’à 65 mètres, pour la pyramide du soleil, le plus grand bâtiment de Teotihuacan, la bien mal nommée, puisqu’elle était en fait dédiée au dieu de la pluie, ce qui a plus de sens considérant l’aridité de la région et l’importance accordée à la pluie par les civilisations mésoaméricaines. On retrouve alors sur un des côtés une volée de marche droite et très raide permettant d’accéder au bâtiment perché sur la pyramide. Impossible de ne pas se sentir minuscule en s’approchant, dominé par l’édifice imposant ; et pourtant, Teotihuacan a perdu la magnificence qu’elle avait à son apogée, au milieu du premier millénaire. La ville compte alors entre 150 000 et 250 000 habitants, ce qui en fait la plus grande du monde. C’est une cité multiethnique, réunissant nahuas, otomis, totonaques (qui affirmaient en être les bâtisseurs), mayas et zapotèques, qui forment ensemble la véritable civilisation de Teotihuacan. Les bâtiments et pyramides qui restent aujourd’hui, tous proches de la ville de Mexico, semblent perdus et solitaires au milieu de la vaste plaine aride ; il n’en reste que l’adobe gris foncé, et même les « chapulines », de gros criquets consommés depuis 3 000 ans, sont gris-noirs. Pour se faire une idée de l’organisation dense et autrefois vivante de la ville, il ne reste plus que le tracé des rues droites, de la grande avenue centrale de quatre kilomètres, que les Aztèques ont plus tard baptisée « chaussée des morts, et des plus grandes pyramides et chapes des bâtiments. Si ces restes sont toujours si impressionnants, imaginez ce que ressentait un nouvel habitant arrivant vers l’an 600 au milieu de ce tumulte, alors que les pyramides et bâtiments d’adobe sont encore recouverts de stuc bien lisse, d’un blanc éclatant au soleil, peint de couleurs flamboyantes, en particulier du rouge de l’hématite – comme les temples grecs – et du fameux bleu maya. On ne connait malheureusement pas précisément l’histoire de la ville, dont la civilisation s’est éteinte bien avant l’arrivée des conquistadors, si ce n’est qu’elle a subi plusieurs incendies, peut-être volontaires et accompagnant des changements de gouvernements, voire de mode de gouvernance, avant de décliner et que la ville ne soit abandonnée, peut-être suite à des tensions internes, des pillages étrangers ou un peu de tout ça. Les premiers Toltèques font possiblement partie de ces pillards, avant de fonder leur capitale Tula non loin de là. La pyramide du soleil, celle de la lune, et tous ces temples de Teotihuacan s’inscrivent en fait dans une tradition bien plus ancienne en Amérique centrale et au-delà. Les olmèques, civilisation apparue 2500 ans avant l’ère commune, et disparue vers 500 AEC, érigeaient déjà des montagnes artificielles, prémisses de ces pyramides, et ce sont les mayas qui leur ont apporté des façades taillées et peintes de scènes politiques et religieuses, finissant par recouvrir toute la pyramide de stuc, à la recherche d’une surface parfaitement lisse et entièrement peinte de rouge ou d’une autre couleur vive. On peut encore observer ces étonnantes couleurs, rouges, turquoises, jaunes et noirs, qui sont restées protégées jusqu’à nous dans les parties intérieures ou abritées des ruines, et constater avec surprise de leur étonnante vivacité conservée 1500 ans plus tard, qui rappelle les rares codex préhispaniques qui nous sont parvenus.
La couleur ne se limite évidemment pas qu’à l’architecture, elle est portée au quotidien, non seulement sur les vêtements, mais aussi sur la peau peinte et les cheveux teints, de couleurs pouvant être très vives, au contraire des civilisations précolombiennes d’Amérique du Nord, qui affectionnent particulièrement l’ocre et les peintures noires sur le corps et le visage. Les habits peuvent être très complexes, très colorés et souvent ornés de plumes ; les bijoux sont portés gros et nombreux par les classes de haut rang, alors que les prisonniers mayas sont dépouillés de leurs vêtements, et qu’on peut leur imposer le port de boucles d’oreille de papier en guise d’humiliation. Les dents pouvaient être limées pour leur donner une forme artificielle, tout comme des scarifications, lignes et points, accompagnent la peinture corporelle sur le visage et les avant-bras. Les mayas pouvaient aller jusqu’à creuser de petites cavités dans leurs dents pour y loger des pierres précieuses, jade ou turquoise. Le jade vert est en effet une pierre particulièrement importante, qui symbolise la pérennité, l’humidité, la fertilité, la renaissance, l’essence vitale… Et la brillance, celle des métaux et des pierres, ou des surfaces polies, de l’obsidienne ou de l’hématite, ouvrent une lucarne sur les mondes surnaturels et sont des points de passage vers les autres plans de l’univers. On retrouve tous ces aspects sur les masques funéraires de jade, dont un des plus célèbres et le masque du roi maya K’inich Janaab’ Pakal, datant du 7e siècle13. Ces masques constitués principalement de jade de plusieurs nuances de vert différentes, mais aussi de coquillages, et d’obsidienne, permettent aux défunts gouvernants d’accéder à la divinité posthume.

- Le muralisme mexicain est un mouvement artistique qui fait suite à la révolution de 1910, dont les trois artistes les plus influents, « los tres grandes », sont Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros. Ce mouvement se veut accessible à tous types d’observateurs, incluant les analphabètes, par des peintures murales et de grandes fresques réalisées dans des lieux publics, à la gloire de la révolution et des classes prolétaires et paysannes. ↩︎
- Les codex mésoaméricains étaient une forme originale de manuscrits peints sur divers matériaux, formant des bandes, jusqu’à plus de 12 mètres, pilées en accordéon. ↩︎
- Eulalio Ferrer, Los lenguajes del color, 1999. ↩︎
- Ibid. Eulalio Ferrer Rodriguez (1920 – 2009) est un homme d’affaires, publiciste et grand mécène hispano-méxicain, réfugié au Mexique lors de la guerre civile espagnole. Il a notamment publié en 1999 Los lenguajes del color, où il explore la couleur dans l’histoire et sa relation aux religions, aux arts, à la politique, à la mode, à la publicité. ↩︎
- Le maïs vient de la domestication d’une plante mésoaméricaine sauvage, la téosinte, dont la culture a commencé il y a 9 000 ans. Il a joué un rôle déterminant dans l’histoire de la civilisation Maya. ↩︎
- Le ceiba est un genre d’arbre, pouvant atteindre une grande hauteur, jusqu’à 70 m, les faisant émerger au-dessus des forêts tropicales. ↩︎
- Christina Hattler, Oaxacan Indigo, mexchic.co. ↩︎
- Alberto A. Tagle et al., Maya Blue: Its Presence in Cuban Colonial Wall Paintings, Studies in Conservation, 1990. ↩︎
- Greg Borzo, Centuries-old Maya Blue mystery finally solved, 2008. ↩︎
- Domínikos Theotokópoulos, dit El Greco (1541 – 1614), est un peintre né en Crète (alors possession de la république de Venise) mais surtout actif en Espagne. Il est considéré comme le fondateur de l’École espagnole du 16e siècle ; son œuvre très atypique mêle le maniérisme de la renaissance et l’art byzantin, caractérisée par des formes allongées et une palette de couleurs diversifiée mêlant vivacité et austérité. Il a influencé aussi bien Picasso que Pollock au 20e siècle. ↩︎
- Pietro Allevi et al., The first total synthesis of carminic acid, Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 1991. ↩︎
- Eulalio Ferrer, Los lenguajes del color, 1999. ↩︎
- Actuellement conservé au musée national d’anthropologie de Mexico. ↩︎

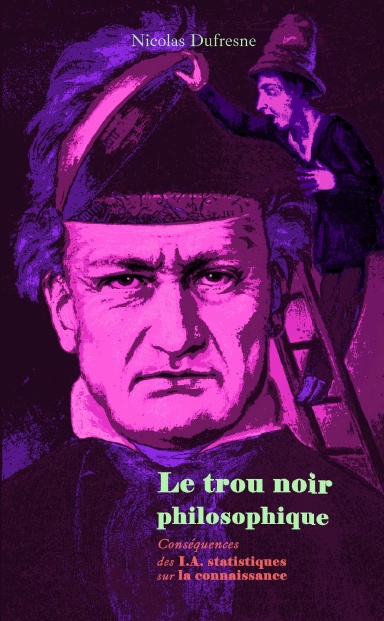
Laisser un commentaire